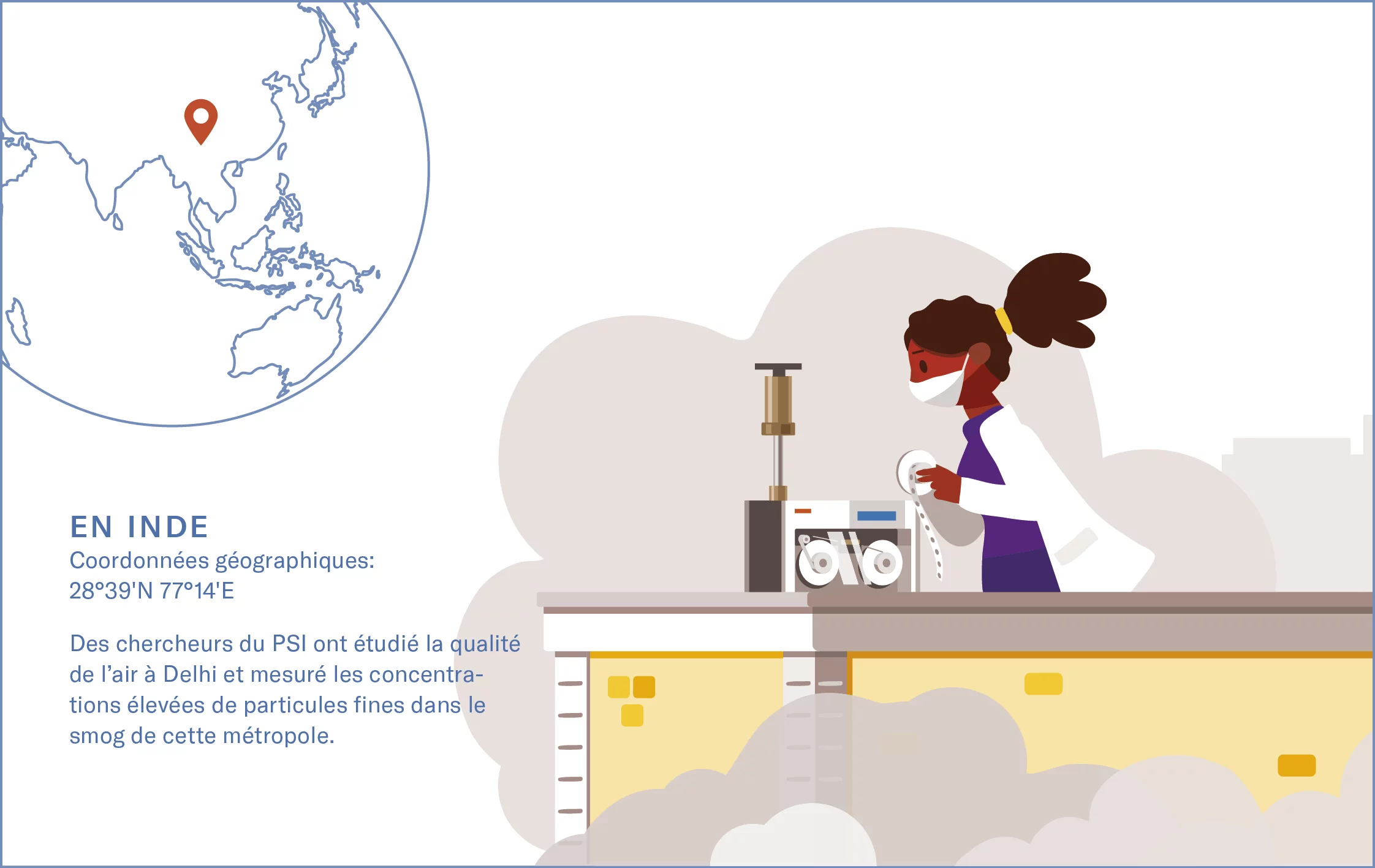Les chercheurs du PSI forent, en haute montagne, dans des glaciers millénaires et analysent, à Delhi en Inde, les concentrations de poussières fines les plus élevées du monde. Ils contribuent ainsi à élucider les questions globales liées au changement climatique et à limiter la pollution atmosphérique.
«C’est vrai, notre recherche est très aventureuse», reconnaît Margit Schwikowski. Chercheuse au PSI et responsable du Laboratoire de chimie de l’environnement, cette chimiste voyage dans le monde entier avec son équipe et une tonne de matériel pour prélever des carottes de glace dans les glaciers de haute altitude. Leur glace, vieille de plusieurs siècles, renseigne en effet sur le passé de la planète. En 2018, Margit Schwikowski a passé deux semaines, en tant que chef d’expédition, sur le glacier du mont Béloukha, qui culmine à 4100 mètres d’altitude dans le massif de l’Altaï, en Sibérie: «Nous étions six personnes venues de Suisse – trois femmes et trois hommes –, avec deux membres du service de sauvetage russe», raconte-t-elle.
Avec son équipement de forage, le groupe a réussi à atteindre le lit rocheux situé tout en bas et à prélever une carotte de glace de 160 mètres. La glace des glaciers est une archive naturelle, car des particules en suspension s’y déposent lors de chaque chute de neige. Plus on fore profondément, plus on peut regarder loin dans le passé. «Je pense que cette nouvelle carotte de glace va nous permettre de remonter jusqu’à dix mille ans en arrière, explique Margit Schwikowski. Lorsqu’elle est située à une profondeur pareille, la glace est particulièrement amincie par la pression et par le temps. Du coup, les dépôts de différents siècles se succèdent à des intervalles de quelques centimètres.»
Les chercheurs du PSI soumettent les particules organiques disponibles dans la glace à ce qu’on appelle la «datation par le radiocarbone», une méthode surtout utilisée en archéologie et en paléontologie. A cette fin, d’infimes quantités de carbone leur suffisent. «Nous avons développé cette méthode pour dater la glace et nous sommes toujours les seuls dans le monde à être capables de le faire, souligne la chimiste avec fierté. De ce fait, on nous envoie des échantillons de glace du monde entier.»
En 2001, le groupe de recherche avait déjà prélevé une carotte de glace plus courte sur le glacier du mont Béloukha. Elle avait permis de remonter sept cent cinquante ans en arrière et fourni pléthore de résultats. A partir de la composition des molécules d’eau, les chercheurs avaient réussi à reconstruire l’évolution des températures de la région au fil du temps. En concordance avec les études globales sur le réchauffement climatique, ils avaient montré que les fluctuations de l’ère préindustrielle s’expliquaient par les différences d’activité du Soleil, alors que ce n’était pas le cas de la forte augmentation des températures survenue après 1850.
De l’argent pour Catherine la Grande
Outre des informations sur le climat, la glace fournit des renseignements historiques: celle du mont Béloukha a permis aux chercheurs de mettre en évidence la présence, dès 1770, de polluants dans l’atmosphère, liés à l’extraction de l’argent. A cette époque, Catherine la Grande régnait sur la Russie. L’argent extrait dans le massif sibérien de l’Altaï était utilisé pour fabriquer les pièces de monnaie du pays.
Aujourd’hui, la glace du forage de 2001 est presque complètement épuisée, et les chercheurs se réjouissent de disposer du nouveau matériau. La carotte de glace, d’une épaisseur de 8 centimètres, a été découpée en tronçons de 70 centimètres et répartie dans quinze caisses isolantes. Elle a été acheminée jusqu’en Suisse d’abord par hélicoptère, puis par camion frigorifique et enfin par avion. «Nous avons dû veiller à ce que rien ne reste coincé à la douane», raconte Margit Schwikowski, avant de décrire le précieux chargement avec enthousiasme: «Pour moi, en tant que spécialiste de l’analyse des traces, la glace est un supermatériau. Mais, actuellement, les glaciers reculent de manière dramatique et, avec eux, c’est notre objet de recherche qui disparaît.» Pour cette raison, la chercheuse participe à l’initiative Ice Memory, soutenue par l’Unesco. L’idée est de stocker en Antarctique des carottes de glace provenant des glaciers de haute montagne du monde entier afin qu'elles restent conservées pour les générations futures.
La surface de la glace à la lumière des rayons X
La glace et la neige sont aussi un objet de recherche au sein du groupe Chimie des surfaces, également rattaché au Laboratoire de chimie de l’environnement de Margit Schwikowski. Plus précisément, ces chercheurs se penchent sur les propriétés physiques et chimiques des couches supérieures de cristaux à la surface de la glace. A l’aide de la lumière de type rayons X de la Source de Lumière Suisse SLS au PSI, les chercheurs déterminent la structure et la composition des dix premiers nanomètres (millionièmes de millimètre) des surfaces de glace. L‘équipe s’efforce entre autres de découvrir comment les gaz et les particules fines s’y déposent, information cruciale pour l’analyse des carottes de glace. Autre aspect important: la manière dont ces substances influent sur le pouvoir réfléchissant (albédo) de la surface de la neige, qui joue un rôle au niveau du climat, et sur les réactions chimiques dans l’atmosphère. «Nos résultats sont intégrés à une banque de données qui forme le corpus de connaissances sur lequel s’appuient les modèles climatiques», précise Markus Ammann, responsable du groupe de recherche.
Des aérosols qui influencent le climat
Quel est l’impact sur le climat et sur notre santé des particules qui flottent dans l’atmosphère et que l’on appelle aussi aérosols, poussière fine ou particules fines? Cet aspect, les chercheurs du Laboratoire de chimie de l’atmosphère au PSI l’étudient eux aussi. «Les aérosols influencent le climat de diverses manières», explique Urs Baltensperger, directeur du laboratoire. Les origines de ces particules sont nombreuses: les particules de suie, issues de la combustion, aussi bien que les cristaux de sel marin sont des aérosols. Il existe des aérosols solides ou liquides, et leur taille peut varier considérablement. De la même manière, les processus induits dans l’atmosphère sont très divers: certains aérosols absorbent la lumière du Soleil, ce qui les chauffe et contribue au réchauffement de l’atmosphère; d’autres réfléchissent la lumière vers l’espace et ont donc un effet refroidissant. Par ailleurs, les aérosols servent de support aux gouttelettes à l’origine de la formation des nuages. «Plus il y a d’aérosols, plus les nuages sont blancs et nombreux», résume Urs Baltensperger. Les nuages refroidissent eux aussi le climat, car ils protègent du rayonnement solaire.
S’ils veulent étudier l’impact des aérosols naturels – sans les effets des particules fines d’origine anthropique – sur la formation des nuages, les chercheurs doivent se rendre dans des régions très isolées. «Pour trouver de l’air complètement propre, il faut aujourd’hui aller dans les régions polaires», affirme Julia Schmale, responsable du groupe de recherche Processus moléculaires des clusters et des particules au laboratoire d’Urs Baltensperger. La chercheuse et ses collaborateurs participent à des expéditions internationales. Il y a deux ans, ils ont fait le tour du continent Antarctique à bord d’un brise-glace; le Swiss Polar Institute rattaché à l’EPFL avait organisé cette expédition. A l’été 2018, en revanche, Julia Schmale et ses collègues se sont rendus en Arctique, où plusieurs groupes de recherche se sont partagés un navire qui leur a servi de «laboratoire flottant».
Outre les effets des aérosols, les chercheurs du laboratoire d’Urs Baltensperger étudient l’origine des particules fines. Près de la moitié sont issues de ce qu’on appelle des sources primaires: il peut s’agir de moteurs à combustion comme de la nature elle-même. La suie, la poussière provenant de l’abrasion des pneus, la poussière minérale et le sel marin en font partie. L’autre moitié des aérosols apparaissent uniquement dans l’atmosphère, lorsque certains gaz forment des liaisons chimiques. Sur le sujet, trois publications – auxquelles le groupe de travail d’Urs Baltensperger a contribué de manière essentielle – ont fait parler d’elles en 2016: les chercheurs y montraient qu’une part considérable de liaisons organiques naturelles entraînait la formation de nouveaux aérosols dans l’atmosphère. «Nous avons découvert que les substances aromatiques émises par les forêts réagissaient, entre autres, avec l’ozone présent dans l’air et formaient ainsi de nouveaux aérosols», raconte Urs Baltensperger. Les essais avaient été conduits dans une chambre spécialement construite au CERN, à Genève, baptisée CLOUD. Des mesures au Jungfraujoch ont confirmé que ce processus avait aussi cours dans la nature. «Depuis, il est clair qu’il faut prendre en compte cet apport dans les modèles climatiques», souligne Urs Baltensperger.
Mais il n’y a pas que le climat où les aérosols jouent un rôle important: les particules fines peuvent avoir aussi des effets considérables sur la santé humaine. Chaque année, sept millions de personnes dans le monde meurent prématurément des conséquences de la pollution de l’air. C’est pourquoi André Prévôt et son groupe de recherche étudient actuellement la qualité de l’air à Delhi, en Inde. Les concentrations de polluants qu’ils y mesurent sont vingt à trente fois plus élevées qu’en Suisse et principalement issues de sources humaines. Avec leurs appareils et leurs analyses, André Prévôt et son équipe sont en mesure de révéler ces sources et les processus qui produisent beaucoup de poussière fine ainsi que de déduire les mesures susceptibles de remédier à la situation.
Un four chinois dans la chambre à smog
«Il est de notre responsabilité de mettre à profit nos connaissances pour améliorer la qualité de vie sur la Terre entière, affirme André Prévôt. Et si nos résultats contribuaient à améliorer la qualité de l’air en Inde, l’un de mes grands objectifs personnels serait atteint.» En Chine, cela a fonctionné. Les chercheurs du PSI ont réussi à montrer que le smog à Pékin était constitué pour l’essentiel de particules fines secondaires, à la formation desquelles contribuaient aussi des sources très éloignées. Outre les mesures effectuées sur place, le groupe de chercheurs a mené des expériences dans la chambre à smog au PSI. «Nous avons importé un four chinois avec son charbon et nous avons étudié ce que les gaz produits induisaient au niveau de l’atmosphère», explique le chercheur, spécialiste des sciences atmosphériques. Ces connaissances ont conduit le gouvernement à Pékin à interdire l’utilisation des chauffages au charbon en ville et à fermer de nombreuses entreprises dans un rayon de 500 kilomètres. Avec pour résultat le recul de la concentration des polluants, qui a atteint 25 % en cinq ans seulement.
Pour mesurer le smog, les chercheurs ont construit un laboratoire mobile qui leur permet d’analyser sur place la composition de la poussière fine. Entre-temps, ils ont développé un nouvel appareil avec lequel ils peuvent notamment suivre d’autres réactions qui se passent dans les particules fines et qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la santé. «Cela ouvre un champ de recherche complexe avec de nouvelles questions extrêmement importantes, souligne Urs Baltensperger. Cela nous fait plaisir et, pour nous autres chercheurs, c’est très gratifiant!»
Texte: Barbara Vonarburg