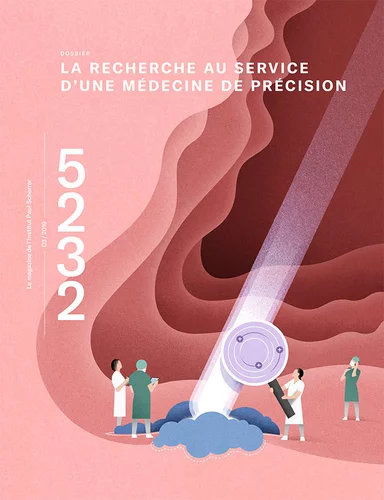La protonthérapie est complexe et plus coûteuse que la radiothérapie conventionnelle, mais sa précision reste inégalée lorsqu’il s’agit de traiter des tumeurs. Damien Weber, directeur du Centre de protonthérapie (CPT) au PSI, n’est pas le seul à en être convaincu. Dans toute l’Europe, on ouvre de nouveaux centres pour traiter les patients cancéreux. En plus d’aider les enfants et les adultes concernés, cela contribue à la sécurité.
Damien Weber, comment se fait-il que l’on traite des patients au PSI?
Les centres de protonthérapie les plus grands et les plus expérimentés sont issus d’instituts de recherche, et ce pour des raisons historiques. Ce traitement nécessite en effet une énorme infrastructure, comme celles du PSI et d’autres centres de recherche. C’est cette infrastructure qui a permis de développer la méthode, de la rendre utilisable sur des patients et de l’améliorer continuellement. La protonthérapie requiert une grande expérience, notamment pour garantir la sécurité des patients et pour obtenir de meilleurs résultats.
Le PSI abrite le seul centre de protonthérapie de Suisse. Est-ce que cela suffit pour prendre en charge tous les patients?
C’est une question délicate mais importante dans un pays où la santé est régulée au niveau cantonal. Si l’on regarde les chiffres, cela suffit pour le moment, car tous les patients pour lesquels une protonthérapie serait indiquée ne sont pas forcément traités de cette manière. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a établi une liste des cancers que l’on peut traiter par protonthérapie. Actuellement, cette liste recense dix indications chez les adultes et tous les cancers chez les enfants et les jeunes de moins de 18 ans. En Suisse, avec deux Gantrys, nous avons deux fois plus de stations d’irradiation par habitant qu’en Grande-Bretagne, par exemple. Un centre de protonthérapie doit présenter une masse critique de patients pour être bon. Si vous n’avez qu’un nombre limité de patients, cette expérience vous manque.
Comment établit-on les indications pour la protonthérapie?
C’est différent dans chaque pays. En Suisse, ladite liste a été établie il y a vingt ans, alors que la protonthérapie n’en était qu’à ses débuts. Depuis lors, on n’y a pas ajouté de nouvelles indications. Même si, en tant que médecin, je suis convaincu par la protonthérapie, nous avons le devoir de fournir des données qui prouvent si, oui ou non, elle fait mieux – et avec moins de complications – que la radiothérapie conventionnelle. Toutefois, le nombre de patients en Suisse est réduit. Nous devons donc collaborer au niveau international pour obtenir suffisamment de données fiables sur la protonthérapie pour chaque pathologie.
Comment entendez-vous apporter ces preuves?
Le nombre de centres de protonthérapie en Europe augmente. En 2024, il y en aura environ trente. Certains d’entre eux se sont associés dans un réseau, l’European Particle Therapy Network, pour mener conjointement des études cliniques sur plus de 300 patients. Le PSI est l’un des fondateurs de ce réseau. Par ailleurs, notre institut est membre associé du réseau américain NRG Oncology. Dans un futur pas trop lointain, il est prévu que le PSI participe à une ou deux études randomisées de phase III. L’une d’elles portera sur le cancer du poumon.
Le poumon bouge quand on respire. Est-il possible d’irradier le cancer du poumon avec autant de précision que des tumeurs situées dans d’autres régions du corps?
Nous avons développé une technique avec laquelle c’est possible. Récemment, nous avons traité de cette façon une jeune femme de 17 ans. C’est une première. Le cancer du poumon est très inhabituel chez les enfants et les jeunes, il touche principalement les adultes. Aujourd’hui, son cancer a disparu. Cela montre à quel point il est important de poursuivre les recherches dans ce domaine pour faire évoluer les méthodes.
Propos recueillis par Sabine Goldhahn
Informations supplémentaires
- Voir aussi l'article: Bombarder les cellules cancéreuses