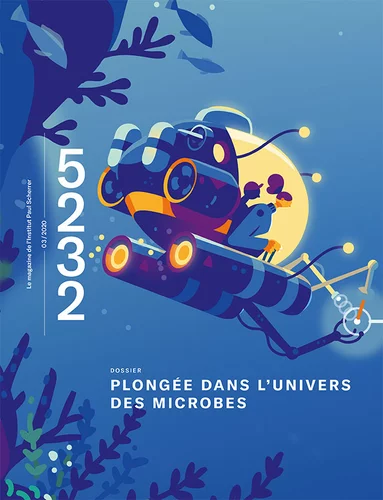Des chercheurs du PSI ont dressé leur camp dans une installation de biogaz sise près de Lucerne. Entre les prés et de gigantesques fermenteurs, ils étudient comment débarrasser le biogaz de ses impuretés afin d’optimiser l’utilisation de ce vecteur énergétique.
Un camion-citerne de transport du lait débouche sur le site de Swiss Farmer Power Inwil (SFPI), à tout juste dix kilomètres au nord de Lucerne. Le conducteur descend de la cabine, fixe une conduite au véhicule et commence à évacuer des déchets laitiers dans une citerne de stockage. En face, une pelleteuse est en train de transporter du lisier de porc, encore fumant, dans un hangar où s’entassent par ailleurs des glumes de blé et des sacs de lait en poudre périmé. Ce sont des denrées destinées à alimenter les principaux collaborateurs de l’installation de biogaz: les micro-organismes qui peuplent des fermenteurs de plus de 1 000 mètres cubes. En digérant cette matière première organique, les micro-organismes produisent, entre autres, du biogaz. Ce précieux vecteur énergétique est constitué en grande partie de méthane, principal composant du gaz naturel.
En Suisse, il se produit chaque année plus d’1,3 tonne de déchets organiques, qui sont transformés en biogaz dans plus de 100 installations, pour une puissance annuelle qui dépasse 400 gigawattheures. A elle seule, Swiss Farmer Power Inwil produit 30 gigawattheures. Le biométhane qu’elle génère est injecté directement dans le réseau de distribution du gaz via un petit tube de 10 centimètres de diamètre. A titre de comparaison: en 2018, il s’est vendu quelque 37000 gigawattheures de gaz en Suisse.
Le biométhane injecté est soumis à des critères de qualité stricts: en Suisse, par exemple, il doit être constitué à 96% de méthane et ne peut contenir au maximum que 2% d’hydrogène et 5 parties par million de sulfure d’hydrogène. Pour produire du biométhane qui puisse être injecté, l’exploitation commence donc par épurer le gaz avec du charbon actif. Ensuite, le dioxyde de carbone, qui représente de 30 à 50% du biogaz brut, est éliminé. Cette élimination est opérée par ce qu’on appelle un «lavage aux amines»: le biogaz est passé à travers une solution chimique de lavage qui fixe le dioxyde de carbone et le sépare ainsi du reste.
Se débarrasser du soufre
Des chercheurs du PSI espèrent qu’à l’avenir il sera possible d’exploiter davantage de biogaz brut pour la transition énergétique. Mais ce dernier contient beaucoup d’autres impuretés qui ne sont guère susceptible de trouver une application à l’avenir. L’objectif est donc d’analyser la composition du biogaz brut de manière aussi précise que possible, mais également d’en éliminer les plus infimes parts de substances interférentes de manière aussi efficace et économique que possible.
«Ce sont les composés organiques sulfurés qui nous donnent le plus de fil à retordre», relève Serge Biollaz, ingénieur et chef de groupe au PSI. Ces composés apparaissent en même temps que le sulfure d’hydrogène, lorsque les bactéries décomposent les protéines qui contiennent des atomes de soufre. Avec d’autres substances interférentes, ils empêchent pour l’instant, par exemple, que le biogaz puisse être utilisé dans une pile à combustible. Celles-ci produisent du courant à partir de gaz riches en énergie, comme l’hydrogène et le méthane. En revanche, les composés sulfurés représentent un véritable poison. Il n’est donc pas possible, pour le moment, d’exploiter des piles à combustible avec des biogaz comme ceux qui sont produits à Inwil.
«Notre objectif est de trouver directement sur place une réponse à cette question, à savoir comment obtenir des biogaz suffisamment purs pour différentes utilisations finales, explique Serge Biollaz. En l’occurrence, des gaz suffisamment purs pour une pile à combustible. » Pour ce faire, le gaz ne doit pas contenir plus de 0,5 partie par million de composés sulfurés. Soit tout juste un dixième de ce qui est autorisé dans le biométhane que SFPI injecte dans le réseau de distribution du gaz.
Une partie de la plate-forme ESI (Energy System Integration) a été transportée à Inwil spécialement à cet effet. Cette plate-forme d’essai du PSI teste les énergies alternatives renouvelables dans leur interaction complexe.
Un conteneur abritant l’installation de recherche Cosyma a été mis en place sur le site de SFPI et un autre conteneur abritant les appareils de mesure pour l’analyse des gaz a été installé à côté. «Dès le départ, cela faisait partie intégrante du concept ESI, souligne Serge Biollaz. Certains éléments ont été installés dans des conteneurs précisément dans l’idée de pouvoir les utiliser sur place de manière flexible, comme en 2017 déjà, à la station d’épuration et de traitement des biodéchets de Werdhölzli à Zurich.»
Utile pour toutes les installations de biogaz
Avec la start-up UniSieve, une spin-off de l’ETH Zurich, les chercheurs du PSI testent en outre, à Inwil, une nouvelle méthode de séparation pour éliminer le dioxyde de carbone du biogaz: il s’agit d’un nouveau type de membrane d’UniSieve qui doit séparer le dioxyde de carbone et le méthane en fonction de la différence de taille de leurs molécules respectives, presque comme une passoire. Si le principe fonctionnait en pratique, cela pourrait encore réduire les coûts de production du biométhane.
Les substrats qui sont servis aux bactéries dans les fermenteurs sont nombreux et divers. Il n’est donc guère étonnant que la composition du biogaz varie beaucoup. «Il y a souvent de désagréables surprises», raconte Philip Gassner, directeur de SFPI. Suivant la bonne forme des bactéries et leur alimentation, le biogaz contient par exemple trop de dioxyde de carbone, puis à nouveau trop de sulfure d’hydrogène.
«Si la qualité du méthane est insuffisante pour qu’il soit injecté, le robinet se ferme automatiquement et nous ne pouvons plus rien injecter dans le réseau gazier, note Philip Gassner. Mais les processus biologiques, eux, continuent sur leur lancée.» SFPI n’a alors pas d’autre choix que de brûler le précieux biométhane. Car ce dernier ne doit en aucun cas se retrouver dans l’atmosphère: il est beaucoup plus dommageable pour le climat que le dioxyde de carbone que dégage sa combustion. «Avec l’aide des chercheurs du PSI, nous espérons mieux comprendre ce qui arrive à notre biogaz lors de son apparition et de sa transformation», souligne Philip Gassner. Au bout du compte, ces connaissances pourraient être utiles à toutes les installations de biogaz du pays.
Du laboratoire à la vraie vie
Serge Biollaz pénètre dans le premier des deux conteneurs ESI installés sur le site de SFPI. Là, le biogaz passe par deux réacteurs successifs. Le premier élimine le sulfure d’hydrogène et les terpènes, des hydrocarbures naturels. Le second est censé éliminer les composés organiques sulfurés, notamment le sulfure de diméthyle qui, selon Serge Biollaz, «cause beaucoup de problèmes et est difficile à séparer». Le sulfure de diméthyle est un composé très répandu sur Terre, puisqu’il est aussi produit dans la mer par le phytoplancton. Mais, pour une pile à combustible, ce composé sulfuré représente lui aussi un véritable poison.
L’objectif est que le biogaz soit suffisamment propre, même pour une pile à combustible.
Pendant des années de travail méticuleux en collaboration avec des partenaires de l’industrie, les scientifiques ont cherché, dans leurs laboratoires au PSI, des matériaux de sorption potentiels qui soient capables d’éliminer les impuretés de manière efficace et d’intercepter une large gamme de substances interférentes. «Nous ne voulons pas devoir tout recommencer à zéro sur chaque site», explique Serge Biollaz. Ce qui fonctionne à Inwil doit aussi pouvoir fonctionner de manière économique dans les autres installations de biogaz en Suisse, avec d’autres compositions de biogaz. Actuellement, les chercheurs testent une zéolithe, un matériau poreux à base de silicium et d’aluminium, capable d’absorber et de retenir des composés organiques sulfurés.
En laboratoire et à la plate-forme ESI, les chercheurs ne disposent pas de biogaz véritable. A la place, ils utilisent des bonbonnes de gaz pour réaliser un mélange gazeux similaire. «Evidemment, ce mélange est différent de ce que produit une véritable installation de biogaz», relève Julian Indlekofer, collaborateur au sein du groupe de Serge Biollaz, qui contribue aux mesures faites sur place à Inwil. «La situation, ici, est particulière, car cette installation utilise tellement de substrats différents», se réjouit-il.
Sur la base des connaissances obtenues, l’objectif des chercheurs du PSI sera d’optimiser l’épuration du biogaz jusqu’à ce que ce dernier soit suffisamment propre, même pour une pile à combustible.
Texte: Brigitte Osterath
Droit à l'utilisation
Le PSI fournit gratuitement des images et/ou du matériel vidéo pour la couverture médiatique du contenu du texte ci-dessus. L'utilisation de ce matériel à d'autres fins n'est pas autorisée. Cela inclut également le transfert des images et du matériel vidéo dans des bases de données ainsi que la vente par des tiers.